Bonjour les yeux !!!!!
[PA d'Or/FR] Syberia 3 (PC/Mac/PS4/X1/SW)
- Aventuria
- Messages : 15866
- Inscription : 21 octobre 2005, 08:41
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Le plancher de PA va trembler.






































































































Bonjour les yeux !!!!!
Bonjour les yeux !!!!!
- vegetable man
- Petit aventurier

- Messages : 113
- Inscription : 07 mai 2008, 15:54
- Localisation : Grenoble
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Le sentiment d'émerveillement est grisant. Mais je crois que c'est se faire des illusions que de penser qu'il est possible de poursuivre ce que l'on a vécu dans Syberia I & II. En tout cas, je n'en suis absolument pas convaincu et j'ai au contraire peur depuis le début, qu'une suite gâche par son existence même, le caractère unique des précédents. Sokal a peut-être besoin de fric, mais je ne pensais pas qu'il irait jusque là.
Un conte est un conte. Je me méfie des digressions artificielles, surtout quand elles sont dictées par l'argent.
- Marie-Calumet
- Grand aventurier
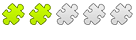
- Messages : 2576
- Inscription : 21 décembre 2005, 19:11
- Localisation : Trois-Rivières, Québec
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
attendons veg, l'avenir nous le dira

- maitrelikao
- Ange gardien de PA
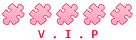
- Messages : 20977
- Inscription : 16 décembre 2008, 16:48
- Localisation : alpes de hautes provence
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Finalement j'aurai préféré une 2° enquête de Jack Norm, problèmes de droits peut être  ?
?
- Aventuria
- Messages : 15866
- Inscription : 21 octobre 2005, 08:41
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Je l'avais oublié ... oui tu as raison maitrelikao, Une bonne idée.maitrelikao a écrit :Finalement j'aurai préféré une 2° enquête de Jack Norm, problèmes de droits peut être?
-
wedge
- Aventurier de PA

- Messages : 1455
- Inscription : 06 octobre 2004, 07:54
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Dans tous les cas nous ne pouvons qu'attendre et croiser les doigts  On espérera bien que c'était dans la tête de Mr Sokal depuis bien longtemps
On espérera bien que c'était dans la tête de Mr Sokal depuis bien longtemps  C'est vrai qu'il est difficile de voir après tout ce que l'on a découvert dans les deux premiers jeux, comment on peut poursuivre l'aventure.
C'est vrai qu'il est difficile de voir après tout ce que l'on a découvert dans les deux premiers jeux, comment on peut poursuivre l'aventure.
- vegetable man
- Petit aventurier

- Messages : 113
- Inscription : 07 mai 2008, 15:54
- Localisation : Grenoble
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Au cas où des personnes n'aient jamais joué ou terminé Syberia, je précise que mon message évoque largement certaines parties des jeux, dont la fin.
Une œuvre crée du sens, opère des résonances sur plusieurs dimensions (poétique, spirituelle, etc).
En créant quelque chose de plus venant s'articuler autour d'un ensemble pensé de manière fini, les résonances qui existaient et opéraient sur et en nous jusque là, en sont à tout jamais changées, parce qu'on en vient à considérer ce surplus. On peut trouver de nombreux exemples en littérature, cinéma, jeu vidéo, etc...
Par ailleurs, une suite reviendrait à rationaliser l'univers de Syberia, et par là-même, son scénario en lui définissant un cadre temporel et spatial. Or, justement, si ces deux jeux ont résonné de manière si profonde en moi, c'est parce que l'histoire tendait au fur et à mesure de son déroulement à l'effacement de ces frontières.
Kate Walker vit dans un univers presque rationnel au début ; elle est avocate, vit à New-York, et est entouré d'un environnement concret, stéréotypé et fermé, voire étouffant : la mère, le petit copain, la meilleure amie, le patron... Mais elle se voit offrir la possibilité de s'évader de cette réalité. Dès le début, Valadilène en donne déjà une vision altérée (la ville semble comme figée dans le temps, et puis l'existence-même des automates que l'on croise n'a déjà presque rien de crédible si on l'analyse de manière terre-à-terre). La suite montre que le mouvement du jeu se fait de l'ouest vers l'est, toujours plus loin, vers le froid et le blizzard.
Quand je jouais à Syberia, l''atmosphère mélancolique me saisissait : j'avais l'impression de dire adieu à chaque personnages que je croisais comme si je n'allais jamais les revoir ; C'est parce que le peu que l'histoire me permettait de connaître de leur personnalité créait un lien d'affection avec eux, et j'arrivais d'autant plus à me projeter à travers Kate et ressentir ce que ressentirait quelqu'un qui effectuerait un tel voyage, dont l'idée qu'il n'en reviendrait pas ; il n'y a qu'une seule voie de chemin de fer, et le train ne peut rouler qu'à sens unique.
À la fin de la partie du jeu se situant à Barrockstadt, on se trouve sur un ancien poste-frontière. En regardant au delà de ce point à travers une lunette, on aperçoit une sorte de grand vide désertique et un arbuste mort, comme s'il n'y avait rien au-delà, en tout cas plus rien n'appartenant au monde connu. C'est la direction que nous suivons pourtant par la suite.
En fait, tout Syberia se situe sur une déchirure entre deux univers, comme si le jeu était lui-même une gigantesque frontière que toute sa vie durant, Hans Voralberg aurait cherché à dépasser. Kate a le choix à la fin du premier jeu de tout arrêter et de revenir à New-York, mais elle dépasse cette frontière et fait de son voyage une quête personnelle dont elle prend l'initiative, celle d'accompagner Hans Voralberg jusqu'au bout.
C'est dans Syberia II que l'on perd complètement les notions d'espaces, de lieu, et de temps. Qu'est-ce que la vallée des mammouths, sinon une sorte de « Neverland » ? Et qui est Hans sinon, un Peter Pan, qui aurait tenté toute sa vie, d'aller là-bas, y parvenant finalement au soir de sa vie ? Toute la mélancolie des jeux tient d'ailleurs du fait que la mort plane constamment sur un monde fragile, se désagrégeant sans cesse, et ce dès l'arrivée de Kate à Valadilène. Plus tard, si Oscar doit mourir, c'est parce qu'il ne peut aller au-delà d'une certaine frontière de par sa nature d'automate (bien sûr d'un point de vue symbolique, non pas dans le cadre du scénario). Une part de lui appartient au monde matériel, et c'est cette part qui va aider Hans à pouvoir continuer physiquement son voyage.
Ce monastère inaccessible et ces vieux ecclésiastiques situés à l'écart du monde – mais pas complètement en dehors – offrent une autre résonance avec la symbolique du jeu.
Enfin, la vallée des mammouths, c'est ce sanctuaire du rêve, figé dans le temps et l'espace, ou plutôt abolie de leur frontières, et qui n'existe sur aucunes cartes.
C'est pour cela que quand Syberia II se termine, je ne me suis pas demandé ce qu'il allait advenir de Kate, car pour moi, à tout jamais, elle regarde Hans s'éloigner vers le néant sur le dos d'un mammouth.
Pour vous, ce que je raconte n'est peut-être qu'une construction intellectuelle complètement artificielle, du blabla grandiloquent, mais je ne fais que traduire avec des mots et des idées ce que j'ai profondément ressenti (je n'ai terminé ces jeux en tout et pour tout, qu'une seule fois il y a 6 ans. Tous les passages que j'évoque sont issus de mes souvenirs; c'est vous dire si j'ai été marqué).
L'Amerzone n'a pourtant pas provoqué d'appel à une suite de la part des joueurs, alors que le jeu racontait une histoire semblable à celle de Syberia, de manière plus schématique et synthétique. Là, personne ne s'est demandé ce qu'il allait advenir du journaliste que l'on dirige alors qu'il n'a aucun échappatoire là où il se trouve. Par rapport à Kate Walker, il ne s'incarne pas à travers un visage : il n'est personne d'autre que nous-même. Paradoxalement, c'est pour que le joueur s'identifie mieux au personnage que l'on incarne que la figure de Kate était nécessaire dans ce cadre narratif (contrairement à celui de Myst par exemple) : sa personnalité un peu fade mais bien présente, permet à chacun de vivre l'aventure à travers elle.
Peut-être avez-vous ressenti des émotions semblables en jouant à Syberia, et peut-être comprenez-vous ainsi pourquoi je trouve si terrible l'idée-même d'une suite. Mais tout cela est lié à la question de comment vous considérez le potentiel d'un jeu vidéo : celui d'un simple divertissement, ou au contraire un potentiel d'échos, de résonances, d'idées et de poétiques capables de changer votre regard sur le monde dans lequel nous vivons, mais aussi sur la place que vous pensez y avoir. J'ai souvent lu que le jeu vidéo était un média cloisonné et cloisonnant, mais Syberia fait partie de ces œuvres démontrant le contraire. Et je pensais que nous étions plus nombreux à partager cette idée...
Une œuvre crée du sens, opère des résonances sur plusieurs dimensions (poétique, spirituelle, etc).
En créant quelque chose de plus venant s'articuler autour d'un ensemble pensé de manière fini, les résonances qui existaient et opéraient sur et en nous jusque là, en sont à tout jamais changées, parce qu'on en vient à considérer ce surplus. On peut trouver de nombreux exemples en littérature, cinéma, jeu vidéo, etc...
Par ailleurs, une suite reviendrait à rationaliser l'univers de Syberia, et par là-même, son scénario en lui définissant un cadre temporel et spatial. Or, justement, si ces deux jeux ont résonné de manière si profonde en moi, c'est parce que l'histoire tendait au fur et à mesure de son déroulement à l'effacement de ces frontières.
Kate Walker vit dans un univers presque rationnel au début ; elle est avocate, vit à New-York, et est entouré d'un environnement concret, stéréotypé et fermé, voire étouffant : la mère, le petit copain, la meilleure amie, le patron... Mais elle se voit offrir la possibilité de s'évader de cette réalité. Dès le début, Valadilène en donne déjà une vision altérée (la ville semble comme figée dans le temps, et puis l'existence-même des automates que l'on croise n'a déjà presque rien de crédible si on l'analyse de manière terre-à-terre). La suite montre que le mouvement du jeu se fait de l'ouest vers l'est, toujours plus loin, vers le froid et le blizzard.
Quand je jouais à Syberia, l''atmosphère mélancolique me saisissait : j'avais l'impression de dire adieu à chaque personnages que je croisais comme si je n'allais jamais les revoir ; C'est parce que le peu que l'histoire me permettait de connaître de leur personnalité créait un lien d'affection avec eux, et j'arrivais d'autant plus à me projeter à travers Kate et ressentir ce que ressentirait quelqu'un qui effectuerait un tel voyage, dont l'idée qu'il n'en reviendrait pas ; il n'y a qu'une seule voie de chemin de fer, et le train ne peut rouler qu'à sens unique.
À la fin de la partie du jeu se situant à Barrockstadt, on se trouve sur un ancien poste-frontière. En regardant au delà de ce point à travers une lunette, on aperçoit une sorte de grand vide désertique et un arbuste mort, comme s'il n'y avait rien au-delà, en tout cas plus rien n'appartenant au monde connu. C'est la direction que nous suivons pourtant par la suite.
En fait, tout Syberia se situe sur une déchirure entre deux univers, comme si le jeu était lui-même une gigantesque frontière que toute sa vie durant, Hans Voralberg aurait cherché à dépasser. Kate a le choix à la fin du premier jeu de tout arrêter et de revenir à New-York, mais elle dépasse cette frontière et fait de son voyage une quête personnelle dont elle prend l'initiative, celle d'accompagner Hans Voralberg jusqu'au bout.
C'est dans Syberia II que l'on perd complètement les notions d'espaces, de lieu, et de temps. Qu'est-ce que la vallée des mammouths, sinon une sorte de « Neverland » ? Et qui est Hans sinon, un Peter Pan, qui aurait tenté toute sa vie, d'aller là-bas, y parvenant finalement au soir de sa vie ? Toute la mélancolie des jeux tient d'ailleurs du fait que la mort plane constamment sur un monde fragile, se désagrégeant sans cesse, et ce dès l'arrivée de Kate à Valadilène. Plus tard, si Oscar doit mourir, c'est parce qu'il ne peut aller au-delà d'une certaine frontière de par sa nature d'automate (bien sûr d'un point de vue symbolique, non pas dans le cadre du scénario). Une part de lui appartient au monde matériel, et c'est cette part qui va aider Hans à pouvoir continuer physiquement son voyage.
Ce monastère inaccessible et ces vieux ecclésiastiques situés à l'écart du monde – mais pas complètement en dehors – offrent une autre résonance avec la symbolique du jeu.
Enfin, la vallée des mammouths, c'est ce sanctuaire du rêve, figé dans le temps et l'espace, ou plutôt abolie de leur frontières, et qui n'existe sur aucunes cartes.
C'est pour cela que quand Syberia II se termine, je ne me suis pas demandé ce qu'il allait advenir de Kate, car pour moi, à tout jamais, elle regarde Hans s'éloigner vers le néant sur le dos d'un mammouth.
Pour vous, ce que je raconte n'est peut-être qu'une construction intellectuelle complètement artificielle, du blabla grandiloquent, mais je ne fais que traduire avec des mots et des idées ce que j'ai profondément ressenti (je n'ai terminé ces jeux en tout et pour tout, qu'une seule fois il y a 6 ans. Tous les passages que j'évoque sont issus de mes souvenirs; c'est vous dire si j'ai été marqué).
L'Amerzone n'a pourtant pas provoqué d'appel à une suite de la part des joueurs, alors que le jeu racontait une histoire semblable à celle de Syberia, de manière plus schématique et synthétique. Là, personne ne s'est demandé ce qu'il allait advenir du journaliste que l'on dirige alors qu'il n'a aucun échappatoire là où il se trouve. Par rapport à Kate Walker, il ne s'incarne pas à travers un visage : il n'est personne d'autre que nous-même. Paradoxalement, c'est pour que le joueur s'identifie mieux au personnage que l'on incarne que la figure de Kate était nécessaire dans ce cadre narratif (contrairement à celui de Myst par exemple) : sa personnalité un peu fade mais bien présente, permet à chacun de vivre l'aventure à travers elle.
Peut-être avez-vous ressenti des émotions semblables en jouant à Syberia, et peut-être comprenez-vous ainsi pourquoi je trouve si terrible l'idée-même d'une suite. Mais tout cela est lié à la question de comment vous considérez le potentiel d'un jeu vidéo : celui d'un simple divertissement, ou au contraire un potentiel d'échos, de résonances, d'idées et de poétiques capables de changer votre regard sur le monde dans lequel nous vivons, mais aussi sur la place que vous pensez y avoir. J'ai souvent lu que le jeu vidéo était un média cloisonné et cloisonnant, mais Syberia fait partie de ces œuvres démontrant le contraire. Et je pensais que nous étions plus nombreux à partager cette idée...
Dernière modification par vegetable man le 28 novembre 2012, 01:14, modifié 3 fois.
- Aventuria
- Messages : 15866
- Inscription : 21 octobre 2005, 08:41
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Très bien vu Veg. Très belle observation. 

Je suis déchirée entre une suite et pas de suite. Mon désir de replonger dans cet univers de Syberia est tellement encré en moi que je rêve d'y retourner. Aucun jeu ne m'avait laissé une telle impression de vide quand j'ai du quitter Syberia et en même temps de joie d'avoir amené Hans devant son rêve. Ce rêve devenu le mien au cours du jeu.
Une suite à Syberia arrivera-t-elle à me combler ? La magie fonctionnera-t-elle une autre fois ? Je l'espère si une suite est vraiment programmée.
Je l'espère si une suite est vraiment programmée.
Pour moi un jeu de Benoît Sokal est toujours le bienvenu. Les dessins sont magnifiques et les histoires fantastiques et belles comme dans, pour ne signaler que cet autre jeu, L'Amerzone. Les lieux sont tout simplement magiques.
Je suis déchirée entre une suite et pas de suite. Mon désir de replonger dans cet univers de Syberia est tellement encré en moi que je rêve d'y retourner. Aucun jeu ne m'avait laissé une telle impression de vide quand j'ai du quitter Syberia et en même temps de joie d'avoir amené Hans devant son rêve. Ce rêve devenu le mien au cours du jeu.
Une suite à Syberia arrivera-t-elle à me combler ? La magie fonctionnera-t-elle une autre fois ?
Pour moi un jeu de Benoît Sokal est toujours le bienvenu. Les dessins sont magnifiques et les histoires fantastiques et belles comme dans, pour ne signaler que cet autre jeu, L'Amerzone. Les lieux sont tout simplement magiques.
- ClemsPaw
- Aventurier intrépide
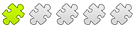
- Messages : 485
- Inscription : 18 août 2006, 14:48
- Localisation : Pays des Morts
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Quand je lis votre engouement et le rêve que vous a apporté les Syberia, je me dis que je suis passé à côté de quelque chose. J'ai beaucoup aimé y joué, mais je n'ai pas ressenti la même chose, je ne me rappelle pas avoir autant été en immersion.
En tout cas, quand je lis ce que tu en dit Veg, ça me donne envie d'y rejouer !
En tout cas, quand je lis ce que tu en dit Veg, ça me donne envie d'y rejouer !
- Epok
- Ange gardien de PA
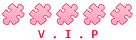
- Messages : 16280
- Inscription : 19 octobre 2005, 19:59
- Localisation : Château des Carpettes
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Merci veg pour cet avis qui vient du coeur ! J'étais émue quand je t'ai lu, tant de souvenirs !
Un grand merci pour avoir mis les mots justes sur nos émotions partagées !
Un grand merci pour avoir mis les mots justes sur nos émotions partagées !
-
Zebulon
- Petit aventurier

- Messages : 145
- Inscription : 29 septembre 2010, 21:24
Re: [News] Syberia 3
Je partage parfaitement ce point de vu et les sentiments ressentis lors de la découverte de cette aventure. J'y ai joué plusieurs fois avec beaucoup de plaisir.
J'espère que la plume de Sokal va nous émerveiller encore. J'ai quand même peur d'une suite qui n'apporte rien. J'aurai préféré un autre conte.
J'espère que la plume de Sokal va nous émerveiller encore. J'ai quand même peur d'une suite qui n'apporte rien. J'aurai préféré un autre conte.
- vegetable man
- Petit aventurier

- Messages : 113
- Inscription : 07 mai 2008, 15:54
- Localisation : Grenoble
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Du cœur!Epok a écrit :Merci veg pour cet avis qui vient du coeur ! J'étais émue quand je t'ai lu, tant de souvenirs !
Un grand merci pour avoir mis les mots justes sur nos émotions partagées !
Au passage Epok, c'est très gentil à toi d'avoir publié mon message en tant que news (et puis quel honneur!^^).
Je considère qu'une œuvre échappe en quelque sorte à son auteur, d'abord parce qu'on n'est plus le même entre le moment où on la crée et des années après - il me semble que c'est une question de vécu et d'état d'esprit. Ensuite, quand on crée, on le fait aussi de manière inconsciente, en sentant les choses, et l'auteur peut très bien ne pas/plus voir tout ce qu'il avait en lui au moment de créer. Ça peut paraître très prétentieux de dire cela, mais ça n'enlève aucun mérite à Benoit Sokal, bien au contraire. Créer quelque chose dont l'on maitriserait tous les aspects de A à Z serait vraiment triste (je veux dire en art, pas dans l'industrie automobile). Le génie de Sokal dans Syberia, c'est d'avoir construit une œuvre résonnant bien au-delà de lui-même (et spécifiquement à travers le médium du jeu vidéo, qu'on a rarement employé ainsi).
Je ne veux pas dire par là que Sokal ne devrait pas faire Syberia III, parce que son œuvre ne lui appartiendrait plus - d'ailleurs qui serais-je pour dire cela? Non, simplement, j'espère que sa démarche est spontanée et artistique et ne fait pas suite à la demande des joueurs et des éditeurs, ou à une pression financière, mais j'en doute fortement au vue du nombre d'annonces contradictoires que l'on a connu depuis l'annonce du jeu. En passant, je trouve d'ailleurs son communiqué de presse très "langue-de-bois", et le fait qu'il annonce la poursuite "des aventures de Kate Walker" n'a rien pour me rassurer.
La question que l'on peut se poser en tant que fan est: pourquoi souhaiterions-nous une suite à Syberia? Je crois qu'Aventuria y a déjà répondu.
Quoiqu'il en soit, Syberia III est maintenant sur les rails. J'aimerais juste que Benoit Sokal le crée en ayant bien à l'esprit ce que j'ai pu exprimer dans mon message précédent. (Que faire à ce niveau-là d'ailleurs? Si vous avez une idée pour le contacter...)
Moi aussi, j'aimerais bien qu'il crée à nouveau des jeux vidéo. Mais comme Zebulon, j'aurais sans doute préféré un autre conte...
Dernière modification par vegetable man le 29 novembre 2012, 19:28, modifié 1 fois.
-
Zebulon
- Petit aventurier

- Messages : 145
- Inscription : 29 septembre 2010, 21:24
Re: [News] Syberia 3
Après Syberia, Benoît SOKAL a créé Paradise qui est aussi un conte dans un contexte plus sombre. Il a dessiné la BD Kraa qui aurait pu être déclinée en jeu vidéo si White Birds n'avait pas déposé le bilan.
Benoît SOKAL c'est un conteur, il a de l'expérience et il est exigent. On peut lui faire confiance sur Syberia III, il saura nous surprendre (mais j'ai peur quand même).
Benoît SOKAL c'est un conteur, il a de l'expérience et il est exigent. On peut lui faire confiance sur Syberia III, il saura nous surprendre (mais j'ai peur quand même).
- Aventuria
- Messages : 15866
- Inscription : 21 octobre 2005, 08:41
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Je me dis que Benoît Sokal a bien du peser le pour et le contre avant de se lancer dans l'aventure. Il sait que si Syberia III est attendu il sera également sur la sellette. Les fans ne lui passeront rien et les critiques seront vives.
S'il se lance dans ce Syberia III, il doit avoir déjà en mains une bonne trame de jeu. Enfin je suppose.
Je me rassure comme je peux.

S'il se lance dans ce Syberia III, il doit avoir déjà en mains une bonne trame de jeu. Enfin je suppose.
Je me rassure comme je peux.
- Jade-
- Apprenti aventurier
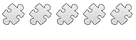
- Messages : 10
- Inscription : 01 avril 2007, 23:37
- Localisation : Bruxelles
- Contact :
Re: [News] Syberia 3
Moi également, je te remercie, cher Veg, pour ton analyse magnifique de ce superbe jeu, qu'est Syberia, et qui nous a tous marqués tant par sa poésie et sa magie qui nous ont envahis. Il est toujours mon préféré parmi la bonne centaine de jeux effectués.
La tâche de B. Sokal sera rude pour ne pas décevoir ses multiples fans, toujours sous le charme des premiers opus mais je veux y croire de toutes mes forces
La tâche de B. Sokal sera rude pour ne pas décevoir ses multiples fans, toujours sous le charme des premiers opus mais je veux y croire de toutes mes forces
-
- Information
-
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités